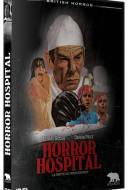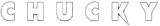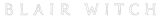Critiques spectateurs de Frank zito
Pages
Une Hache pour la Lune de Miel
Le film s’engage dans un train lancé à grande vitesse. On y suit un homme visiblement tendu traverser les couloirs étriqués des wagons jusqu’à croiser le regard d’un enfant inexpressif occupé à suivre le paysage défiler. Sans le lâcher des yeux, il ouvre une porte et pénètre discrètement dans une cabine. Là il trucide un couple enlacé à coup de hachoir, puis essuie patiemment l’arme du crime dans la tulle immaculée d’une robe de mariée. La réalisation splendide de Mario Bava, associé à un montage onirique et original pour l’époque place immédiatement le film en apesanteur. Et ce n’est pas tout. Le scénario aussi semble furieusement moderne. En effet, le tueur utilise ses pulsions afin de recomposer un souvenir fondamental, chaque meurtre étant une pierre de plus à la reconstitution de sa psyché amputée. Couturier esthète, amoureux des fleurs, ce personnage décadent à la Bret Easton Ellis, dominé par sa fêlure (Il a la fâcheuse tendance d’enlacer des mannequins déguisées en mariées, et d’embrasser langoureusement leurs joues plastifiées) reste parfaitement conscient de ses actes, qu’il assume avec un détachement méprisant. Pas de whodunit, donc, mais un chassé croisé impitoyable entre un policier (très patient) et ce souvenir insaisissable qui ne doit sa construction qu’aux passages à l’acte du tueur. Qui, des deux, réussira à boucler son enquête le premier, là est l’enjeu. Torture de l’image et du son, prises de vues audacieuses mêlées à un classicisme délicieux, zooms déraisonnables et flous inquiétant, Mario Bava fait feu de tout bois, exploite à fond la richesse de son scénario, tord la temporalité, invente sans tabous, s’amuse même quand il met en scène la femme ectoplasme du couturier qui n’accepte pas d’être larguée, même après la mort ! Accumulant les scènes de bravoure, Une hache pour la lune de miel est donc un film majeur, d’une extrême richesse, qui perd de justesse un statu d’œuvre culte qu’il aurait pu mériter sans une dernière bobine, hélas, moins inspirée. Un grand Bava quand même.
Publié le 13 Novembre 2008
Le Piège
Et c’est reparti pour un tour ! Cinq copains en vacances (Deux branleurs, de type élevés aux hormones un peu serrés dans leurs moule-burnes, et trois jeunes filles pas frileuses, dont l’inoubliable Tania Roberts seulement habillée d’un short qui taillerait grand pour une poupée Barbie) tombent en panne dans le trou du cul du monde. Situation qu’ils prennent tous à la rigolade, avant de se séparer les uns après les autres (Toutes les quinze minutes de préférence), et de se rendre compte qu’ils auraient mieux fait de le prendre au sérieux, ce péquenot en salopette qui rabâche ses vieux souvenirs sur « l’Oasis perdu de Slausen », son motel miteux qui a fait faillite depuis qu’un autoroute en a détourné la clientèle. Et puis c’est vrai que le bougre ne cherche qu’à les aider ! Si, si ! Ecoutez sa voix sucrée qui tranche d’avec son physique rustaud… Et son beau sourire qui adoucit une mâchoire pourtant carnassière… D’accord, m’objecterez-vous, il possède bien cette collection de mannequins à l’échelle humaine plutôt bizarre. Et cette sale manie qu’il a de les mettre en garde contre un danger extérieur que personne ne soupçonnait… Sans parler de l’absence de leur copain qui est allé changer le pneu, il y a des heures de cela, mais que tout le monde semble avoir oublié pour profiter des bons sodas rafraîchissant de l’accueillant père Slausen. Bref, tout porte à croire qu’on se trouve devant le énième slasher de l’époque, con et insignifiant à la fois. Et bien c’est volontaire ! L’absence de caractérisation du groupe de jeunes, leur absurdité crasse, la mécanique des meurtres, le don d’ubiquité du tueur en série, tout ce qui fait le genre est ici porté à son paroxysme ! C'est justement ce qui sort Tourist trap de la médiocrité ambiante, son parti pris extrême. Schmoeller, s’il reprend bien les thèmes classiques du slasher, les poussent au bout de leur logique. Sa bande de jeune n’existe « que » pour servir de chair à canon (On ne saura jamais rien d’eux). Son psychopathe est isolé dans une campagne totalement inhabitée (On ne croisera personne d’autre que les six personnages du film). Le musé de cire et l’habitation de Slausen, surréaliste, peuplées de mannequins animés sans aucune fonctionnalité, ne servent que le scénario. Et puis ces portes qui battent toutes seules, ces couteaux qui lévitent, ces poupées qui gémissent… Rien dans Tourist trap n’est ancré dans le réel. C’est une succession de scènes sans queue ni tête à laquelle nous sommes conviés, de plus en plus oniriques jusqu’à un final proprement délirant, schizophrène et unique en son genre, le tout soutenu par un thème qui oscille entre le drame et la comédie. Même si l’on est loin d’Argento, on retrouve dans le métrage de Schmoeller, cette même envie de transcender le genre jusqu’à n’en utiliser que la substantielle moelle, celle la même qui est la plus cinématographique. Dégagé du poids du réalisme, cet enchaînement effréné, dans un premier temps déroutant, finit par entraîner l’adhésion totale. Un film mineur et inégal donc, mais jubilatoire dans son ambition de refuser un postulat rationnel au profit d’un univers magique où tout est possible…
Publié le 2 Novembre 2008
La Fille coupée en deux
Une jeune miss météo, courtisée par l’héritier d’une puissante entreprise pharmaceutique, se prend de passion pour un écrivain à succès libertin qui vit retiré de Paris dans la banlieue lyonnaise. Avec « La fille coupée en deux » Chabrol continu de creuser son sillon, celui d’un cinéma qui fait craquer le vernis de la société bourgeoise, révèle son hypocrisie, son oisiveté écoeurante et ces mœurs dépravées. Longtemps, cette charge acerbe rendait son cinéma jubilatoire, mais les années ont passé, et le maître de perdre beaucoup de sa pertinence en chemin. Car c’est ce qui surprend le plus à la vision de ce film, le manque de pertinence dans la peinture de cette vieille bourgeoisie provinciale atrocement normative confronté au cynisme épicurien d’une nouvelle bourgeoisie plus strass et paillette. Les clichés pleuvent averse. Tout ce qu’entreprend Chabrol est raté. Depuis la jeune fille, (mal) interprété par une Ludivine Sagnier peu aidé par un rôle d’une telle ambiguïté qu’il en devient absurde, à son amant libidineux et blasé (très bon Berléand, hormis dans les scènes de baiser fiévreux, d’une froideur à faire rentrer sa langue pour l’éternité !) en passant par l’incroyable Magimel, aussi mauvais qu’à l’accoutumée, mais aidé ici dans sa médiocrité par un personnage de fils à papa déséquilibré qui lui va comme un gant (A noter qu’il est, comme presque toujours, affublé d’une coupe de cheveux invraisemblable . Sa marque de fabrique ? Un running gag ? Le dîner de cons ? Comment savoir…) Toujours est-il que l’ensemble sonne terriblement faux, le scénario n’est jamais palpitant, et comme la peinture acerbe ressemble plus à une caricature grossière, il restait peu de chose à cette fable contemporaine pour surnager. Et c’est ce dernier point qui la fait couler à pic : en effet, aigri ou usé par toutes ces années à rabâcher les même poncifs, Chabrol oublie en route l’essentiel : aimer ces personnages pour nous permettre une quelconque identification. Dans son métrage, il méprise tous, sans exception ! Leurs faux-semblants, leurs abus de pouvoir, leurs petites renonciations et leur vulgarité que seule masque l’abondance de bien. Et nous de rester imperméables à leurs gesticulations misérables et à leurs destins brisés. Une vraie déception, curieusement saluée par les vivas de la critique cinématographique.
Publié le 25 Octobre 2008
La Nuit des Fous-Vivants
Suite à un accident d’avion, un virus expérimental se répand dans l’atmosphère d’une petite bourgade qui va sombrer dans la folie. Romero, auréolé du titre de pape de l’horreur contestatrice, se lance donc dans une critique acerbe de l’armée et de ses méthodes alors que la guerre du vietnam se termine, abandonnant la société américaine dans la plus grande confusion. Les militaires, qui n’ont donc pas la côte, exterminent dans « The Crazy » la population locale pour ne pas avoir voulu ébruiter l’existence d’une arme bactériologique. Seulement le grand Georges a vu grand. Trop grand. S’il avait pu suggérer l’apocalypse de la nuit des morts vivants en isolant ses survivant dans un espace clôt, il se ramasse lamentablement devant la démesure de son ambition. Et comme il filme le tout comme un morne épisode de Columbo (Décors tristounet, gros plan de mauvais téléfilm, déguisement tout droit sortis d’un magasin discount de farces et attrapes) autant dire que « la nuit des fous vivant » se ramasse la gueule dans les grandes largeurs. La réalisation molle s’éternise sur des acteurs de série Z qui récitent leurs interminables dialogues en cabotinant pire que Christian Clavier dans « les bronzés 3 ». C’est horrible, moche comme jamais et, cerise sur le gâteau, bourré de stock-shot immondes indignes des pires nanards cannibales italiens. Bref, il a tout pour plaire. Sauf que les plus patients, et dieu seul sait qu’il faudra l’être, pourront accéder à la dernière bobine qui, d’un seul coup, voit Roméro reprendre la main. Réalisation plus vive dès lors que sa poignée de héros barre en sucette. Inceste, tuerie, tension, et enfin émotion s’invite à l’écran alors qu’on n’y croyait plus. Et en vingt minutes, on y trouve tout ce que Romero reproduira dans Dawn of the Dead, jusqu’à un final nihiliste parfaitement déprimant, signature même du géant de Pittsburgh. Vingt minutes qui à elle seules valent largement le détour tant elles font le pont entre les deux premiers volets de la saga des morts vivants. Un retournement de situation qui sauve de justesse le métrage du désastre. De justesse seulement…
Publié le 25 Septembre 2008
L'Enfant du Diable
« L’enfant du diable » s’ouvre sur un tragique accident qui voit John Russell assister impuissant à la mort de sa femme et de sa fille, écrasées par un poids lourd prit dans le verglas d’une petite route de montagne. Un morceau de piano délicat et émouvant se lance alors pour accompagner un générique sobre et élégant. Tout est déjà là. Le métrage de Peter Medak restera dans un état de grâce absolu jusqu’à la fin. Ses travellings somptueux nous font découvrir l’une des plus belle maison hantée de l’histoire du cinéma, tout comme ses magnifiques plans fixes ou panoramiques, mémoire d’un savoir faire classique dans lequel l’histoire de cet esprit qui utilise un vieux compositeur endeuillé pour servir sa cause se fond particulièrement bien. Le scénario est d’une solidité rare, de la découverte des lieux et des enjeux au dénouement, il distille habillement et sans grandiloquence tous les poncifs qui ont fait le genre de la malédiction –la boîte à musique et sa ritournelle métallique, les portes qui battent, les lumières qui clignotent, la médium en transe et les voix d’outre tombe enregistrées sur magnétophone- Puis il y a George C Scott, qui habite l’écran avec son physique qui en impose, sa classe naturelle et son charisme placide. Rien dans son jeu n’est outré. Au diapason de la majesté de la réalisation, il apporte une crédibilité et une élégance à son personnage rarement retrouvé dans le cinéma fantastique. Dès lors on le suit sans réserve quand il ouvre une porte dérobée qui donne sur une mansarde à foutre la chiasse, quand il descend à la recherche d’ossements dans un puits dissimulé sous un parquet (Scène déroutante qui a du marquer Hideo Nakata tant on pense à Ring en la découvrant) ou quand il se confronte à un sénateur pour restaurer une vérité qui, seule, pourra ramener la paix dans son existence dévastée. Un grand numéro d’acteur pour un film dont la beauté classique nous rend nostalgique comparée à la laideur formelle du cinéma fantastique contemporain qui, semble-t-il, a oublié ce que grâce veut dire.
Publié le 19 Septembre 2008
Ghosts of Mars
Gracieusement invité par Papa Jupiter à donner mon avis sur Ghost of Mars, après que mon argumentaire sur Doom lui a donné un solide urticaire, je m’exécute donc avec un plaisir tout relatif. Car effectivement le film de Carpenter n’est pas ce que l’on pouvait attendre d’un si grand maître. Las, son histoire de fantômes, sorte de Marilyn Manson d’opérette, associé à un casting épouvantable, l’imbuvable Ice Cube en tête de gondole, tuent dans l’œuf tout espoir de voir le grand John nous pondre un nouveau chef d’œuvre. Associé à un scénario qui tient sur une feuille de papier à rouler et des décors en carton pâte réutilisés à l’infini, on se rend vite compte qu’il s’agit plus d’un gros Z qu’autre chose. Ouf ! Mon honneur est sauf ! Papa Jupiter peut arrêter de gratter son irruption de boutons grâce à ses lignes ! Enfin, je cesse d’avoir des avis « grotesques » pour retrouver le chemin dicté par Papa, préférer l’immonde Doom au raté Ghost of Mars ! Hélas, les démangeaisons risquent de bien vite lui reprendre. Car un monde sépare ses deux métrages : celui des intentions ! En effet, celles de Doom étaient claires : se faire un maximum de thunes sur le dos d’un franchise de jeu vidéo célèbre en tournant un film calibré en projection test devant un public de texans élevés au T.bones. Et voilà devant nos yeux ébahis un produit aussi pasteurisé qu’un fromage nature à tartiner. Alors que Carpenter, lui, aussi has been qu’il soit, se trouve de l’autre coté de la rive. Il a des messages à faire passer par le biais du langage cinématographique, de vraies héroïnes à mettre en avant, un nihilisme toujours aussi extrême à défendre. Alors même si cette envie se traduit dans des répliques bourrines perdues au cœur de dialogues épouvantables, ces intentions rendent Ghost of Mars hautement plus estimable que l’insipide Doom. « Si je meurt, lâche Ice Cube, ce sera en me battant, pas en fuyant » comme pour faire écho à la lutte que mène encore John Carpenter contre le système, comme la volonté de ne pas sombrer dans une certaine forme de stérilisation cinématographique du cinéma de genre, dont Doom est l’un des parfait rejeton. Cinéaste résistant, il signe ici une vraie merde, mais une merde qui à du goût et une odeur. Ce qui, peut-être, peu déchaîner des démangeaisons chez le spectateur trop nourrit aux films inoffensifs de producteurs qui voudraient se faire passer pour des amoureux du genre, mais qui en fait ne sont que d’affligeants hommes d'affaires.
Publié le 18 Mai 2008
28 Semaines Plus Tard
Les survivants d’un virus qui a dévasté l’Angleterre se retrouvent confinés dans un quartier londonien en attendant que la quarantaine soit définitivement levée. Après une scène d’exposition aussi sublime que spectaculaire, qui marquera au fer rouge le personnage incarné par le parfait Robert Carlyle, 28 semaines plus tard va prendre la forme d’un conte apocalyptique. C’est Juan Carlos Fresnadillo qui a pris les commandes de cette séquelle avec l’envie de s’y investir corps et âme, et d’y apporter sa touche personnelle. Loin des gesticulations, aussi spectaculaires que brouillonnes et superficielles, du bordélique Danny Boyle, il s’emploie à nous égarer dans de jolis contre pieds semés dans un scénario à la trame pourtant déjà vue et revue. Son futur apocalyptique, dans un Londres en reconstruction très réaliste, est martial et désenchanté. L’humanité est à bout, sans repère, aussi abîmée à l’intérieur que la chair des vérolés l’est en apparence. Sans souligner sa thématique de manière lourdingue, sans jamais céder à la facilité narrative, multipliant les enjeux non débilitant, Fresnadillo nous offre un film adulte, sans pour autant renier le spectaculaire, le film n’étant pas avare en scène choc, effets gores et action guérilla. La noirceur qui se dégage de 28 semaines plus tard est aussi profonde que désespérée. Portée par une magnifique partition, on ne perd jamais de vue ses protagonistes qui essayent d’échapper à l’inéluctable. Et l’on fini par ne plus savoir si fuir est la bonne solution, quand se laisser aller au virus peu sembler si tentant. En effet, pourquoi ne pas abandonner cette humanité brisée, apeurée et cruelle pour une bestialité décomplexée aux codes simplement dictés par l’urgence ? Fresnadillo reprend donc à son compte certains des questionnements que Roméro abordait dans son raté « Land of the dead » et réussit avec maestria à nous dépeindre un monde vicié et égaré, pour nous conduire sans compromis jusqu’au crépuscule de l’humanité.
Publié le 16 Mai 2008
Doom
Doom ! Bordel ! Rien que le titre faisait frissonner ! Doom ! La légende bien craspec du jeu vidéo adapté au cinéma ! Ouahou ! Chouette ! Ca allait être sale et méchant ! Ca allait sentir la sueur et le sang ! Immédiatement culte ! Pardon? The Rock et Karl Urban dans les rôles principaux, vous dites? Andrzej Barthowiak aux commandes ? 70 millions de dollars ? Ouhlala ! Alors ça doit être de la merde ! Encore un pur produit de studio! De la lessive ! Avec des acteurs rasés de près, aux aisselles propres et déodorisées ! Déjà j’affûte un avis bien saignant…Ca va faire mal ! Et là magie: le film n’est ni bon, ni mauvais. Il n’est rien ! Pur rejeton du cinéma d’exploitation de ce début de XXIème siècle, il ménage la chèvre (le spectateur lambda) et le chou (Le fan hardcore du jeu vidéo ou du film de genre). Il ne déchaîne pas plus de rejet que d’enthousiasme. Rien je vous dis. Même pas de l’ennui. J’aurais tant aimé, comme « Bloodline », le trouver grotesque, mais non. Mon encéphalogramme est resté plat. Comme mort j’étais. Pire même, à la fin, je me suis dit qu’il était pas si mauvais que ça… Doom, c’est la mort du débat d’après ciné. 30 avis, et on est tous plus ou moins d’accord. Comme les vieux d’une maison de retraite devant TF1, on a passé le temps, et on à rien à en dire. Ah, si, bien sûr : les actionner bourrins, c’est quand même mieux quand c’est bien nul…
Publié le 16 Mai 2008
REC
Une équipe de télévision locale tourne gentiment un reportage dans une caserne de pompiers quand une intervention de routine va mal tourner… « Virtuose ! » « Radical ! » « Terrifiant ! » « Phénoménal ! », une fois de plus la machine à superlatif qu’est devenue Mad Movies s’est déchaînée, et une fois encore me voilà au cinéma avec la certitude d’assister à un évènement du genre ! 80 minutes plus tard, me voilà donc sur le trottoir, incrédule, entouré d’adolescents qui n’osent même pas rentrer chez eux tellement ils ont flippé grave. Et pourtant… C’est toujours désagréable le désaccord total. Mais le constat est là : [REC], sans être une purge, ne m’a fait aucun des effets annoncés par Mad. Alors que je devais y trouver « un sentiment de peur palpable », [REC] fait moins peur que Blair Witch. Pire même, il ne fait pas peur du tout. A cela une raison simple : l’immersion du reportage capote dès lors que les réactions de la journaliste, les déplacements trop bien réglés des protagonistes et l’extrême lourdeur de la démonstration théorique sur le pouvoir d’attraction de la caméra rendent le tout aussi spontané qu’une pièce de théâtre d’avant-garde. Sans cette fameuse immersion, que reste il donc ? Des zombis ? Mille fois vus, en mille fois mieux. Un scénario ? Tellement con et prévisible qu’il aurait pu servir à la création d’un jeu vidéo pour bac à solde. Une « Maîtrise technique virtuose » doublée d’une « magistrale mise en scène » ? C’est peut-être là que l’adoration semble rendre aveugle tant la réalisation caricature le style reportage jusqu’à en devenir indigeste. Ici, le caméraman n’est pas capable de cadrer correctement le moindre plan, et je ne vous parle pas de sa tremblote, de ses zooms misérables et des ses flous incompréhensibles qui démontrent une incompétence qui choquerait ma grand-mère. A noter que je n’ai jamais suivi à la télévision un reportage aussi mal filmé de toute mon existence, ce qui tend à démontrer que le caractère « réaliste » de [REC], salué par tous les observateurs, est vraiment exagéré. Alors peut-être que le génie de la paire de réalisateur est d’avoir fait passer un film aussi banal que sans relief, pour une bombe cosmique à ranger au panthéon du cinéma de genre. Après les très moyens « Secte sans nom », « Fragile » et « A louer », une preuve de plus de la surcôte aberrante dont jouit Balaguero dans les média français, réalisateur quelconque qui recycle paresseusement (et sous les vivas de la foule) ses vieilles recettes de films en films (Ici la dernière scène crapoteuse au quatrième, déjà vue cent fois chez Balaguero). Hallucinant de médiocrité.
Publié le 4 Mai 2008
Massacre à la Tronçonneuse : Le Commencement
Après le très vain mais néanmoins plutôt réussi remake de massacre à la tronçonneuse par Marcus Nispel, dont l’attente avait fait trembler les amoureux de l’original, c’est donc tranquillisé que l’on pouvait s’attaquer à cet « séquelle/prequelle » à nouveau produite par Michael Bay. Et bien on avait tout faux ! Tranquillisés eux aussi par l’accueil favorable fait à leur premier jet, ils s’enlisent lamentablement et font à rebours ce que tout le monde craignait de voir dans le Nispel : déshonneur au mythe qu’ils sont censés servir. En cinq minutes on apprend donc que Leatherface est mal né dans l’abattoir familial, qu’il y a grandit et vécu comme une bête, et hop, on passe au remake du Nispel pour se faire un max de pépettes sur le dos d’une franchise miraculeusement relancée. Sauf que les années 70 sonnent faux, que les acteurs sont grotesques et que Liebesman ne sait pas filmer. De bien gros handicaps, surtout quand ils sont additionnés à un scénario aussi flémard. Alors faute de talent, on en fait des caisses pour rendre l’ensemble glauque et bestial, pour raccorder maladroitement le tout à l’original en voulant faire authentique alors que tout fait carton pâte. Même Hoyt, la bonne surprise du précédent opus, cabotine jusqu’à l’écoeurement. Dans ce carnaval superficiel tourné par ce qu’il se fait de pire comme réalisateur, seule l’involontaire ressemblance de Lethearface avec Robert Z’Dar (le Maniac cop) amuse autant quelle attriste. Une mascarade qui n’apporte donc rien à la mythologie. Pire même, en divulguant la soi disant origine du fait divers, ce commencement la désarme jusqu’à la rendre risible. A vomir…
Publié le 27 Avril 2008
Folie Meurtière
Visez plutôt l’introduction fracassante : un homme en train de mener à bien des travaux au bord d’un lac se voit décapité par la pelleteuse de l’employé à qui il était en train de donner ses instructions. Diable! Folie meurtrière débute sur des chapeaux de roue, mais hélas, il aura bien du mal à maintenir l’allure. Ce n’est pourtant pas la faute de Tonino Valerii, qui tient son métrage avec rythme et intransigeance, ni à la toujours magnifique comptine signée Morricone, qui souligne admirablement ce giallo. Non. Seulement le temps passant, le spectateur que je suis, trop habitué aux outrances visuelles et à la démesure du cinéma transalpin de cette époque, appâté par une si belle mise en bouche, est resté sur sa faim. A l’image de ses baisers un peu froid échangés par l’inspecteur (Georges Hilton, très bon) et sa compagne, il manque un peu de chaleur à cette enquête plutôt bien menée. Un honnête giallo, donc, à qui il manque juste un peu de folie.
Publié le 27 Avril 2008
Burger Kill
Quatre gangstas affamés filent casser la croûte au Hella Burger le plus proche. Manque de bol, le Ronald Mc Donald du coin n’est pas aussi amical que l’ignoble clown américain. Comprenez qu’au lieu de décongeler de la viande hachée merdique et jeter des sacs de frites grasses dans de l’huile, il va plutôt hacher nos gentils gansgstas et leur mettre la gueule dans la friteuse. Prometteur, n’est-ce pas ? Hélas tout ce qui suit cette introduction ne sera qu’un immonde succédané des slasher les plus renommés de l’histoire du cinéma. Comme dans tout teenage movie, nous passerons par la case dépucelage de l’héroïne, puis par une séance de Ouija, nous pourrons ensuite admirer un sous-Captain Spaulding faire des réclames ringardes, un sous-tueur-à-la-Scream attaquer avec son masque super moche et faire des morts « à la Jason », mais en beaucoup moins bien, la genèse du meurtrier étant au final inspirée de Freddy. Jamais drôle, jamais effrayant, toujours prêt à copier/coller ses plus ou moins glorieux aînés, mettant en scène des personnages tellement taré qu’au lieu d’être flippant, ils sont grotesque, ce film est une merde de plus achetée en supplément d’un magazine qui semble atteint de cécité quand il s’agit de choisir ses « B-Movies ». Au final, Burger Kill est l’exact pendant de ce qu’il voulait critiquer : le fast food du cinéphile. C’est gras, ça s’ingurgite sans plaisir et ça ramollit le bulbe aussi sûrement qu’un Big Mac bouche les artères. Indigeste.
Publié le 19 Avril 2008
Horror Hospital / La griffe de Frankenstein
Jason n’en peut plus ! Imaginez : il s’échine à écrire de superbes chansons que saccagent des groupes minables ! Ecoeuré après en être venu aux mains avec un travesti à qui il crachait son aigreur, il va profiter d’une offre alléchante pour se ressourcer dans un château isolé de la campagne britannique... Alors d’accord avec toi, Mc Grath, l’histoire est sans queue ni tête. Mais bordel, il fallait vraiment que tu sois de mauvaise humeur pour ne pas apprécier Horror Hospital à sa juste valeur. C’est vrai quoi, comment ne pas se réjouir devant ces bagarres grotesques à peine digne d’un épisode de « l’homme qui tombe à pic » ? Et les aspirations du diabolique docteur Storm ? Hein? Qui trépane ses cobayes pour devenir le maître du monde, mais qui en vingt ans, n’est arrivé qu’à contrôler une poignée d’athlètes décérébrés? Et la vieille Tante Harris, ex tenancière de bordel, qui a quitté le tapin pour partager les noirs dessins du docteur, mais qui, prise de remord en plein métrage, songe à reprendre du service? Sans parler de la Storm-mobile aux lames rétractables qui décapitent les passants et récupère leur tête dans un panier idéalement placé ? Et comment oublier Skip, l’assistant nain grimaçant, aux mimiques tellement signifiantes qu’elles ne veulent jamais rien dire. Tout ça au dépend de nos jeunes héros qui se font matraquer du début à la fin par des zombies gymnastes sans jamais perdre leur enthousiasme… Allez, Mc Grath, je veux bien t’accorder que le film est ridicule et imbécile. Mais pas comme le serait un voisin bête et méchant. Non. Il est ridicule et imbécile comme le copain bourré qui vous fait honte dans une soirée, mais à qui on pardonne tout, parce qu'au fond on l'aime bien quand même…
Publié le 13 Avril 2008
Hostel
Alors qu’ils passaient des vacances gentiment décadentes en Europe, trois amis vont suivre les conseils vaseux d’un étudiant hollandais à qui vous n’auriez pas prêté un euro, et partir la fleur au fusil pour Bratislava, où les femmes, plus désirables les unes que les autres sont particulièrement ouvertes aux relations sexuelles de groupe. Hélas, s’il est vrai que la slave n’est pas farouche, le séjour va vite tourner vinaigre pour nos sympathiques érotomanes qui vont bien plus morfler que conclure en slovaquie. Après une très bonne exposition où Eli Roth réussit à nous rendre crédible ses sympathiques branquignoles, Hostel prend la tournure d’un conte à faire peur, à la limite du fantastique. Intelligemment, il isole Oli, Josh et Paxton dans un Bratislava d’opérette à l’architecture douillette de dépliant touristique qui abrite en fait un enfer insondable. L’incompréhension et le déchaînement de fureur qui frappent les protagonistes fonctionnent donc à plein pot, d’autant qu’ils subissent les pires outrages et que le gore est bien craspec. Jusqu’à ce que, terrifié par sa propre audace, Eli Roth, dans une dernière bobine invraisemblable, transforme un film jusque là dérangeant en un Rape and Revenge nigaud et curieusement politique correct. Tiré par les cheveux, elle rend ainsi Hostel aussi inoffensif qu’un caniche nain alors qu’on pensait avoir à faire à un Pitt bull. Vous dire la désillusion…
Publié le 6 Avril 2008
Sunshine
A bord de l’Icarus, une poignée d’homme à pour mission de rallumer un soleil moribond à l’aide d’un missile qu’il faudra nicher en son cœur. Boyle, qui confirme avec ce film son éclectisme, s’attaque donc à la science fiction sans rien changer à ses recettes cinématographiques. Le spectacle est total, spectaculaire, même si l’ensemble pâti d’une manque de cohésion -due à la richesse d’un scénario à pistes multiples pas toujours bien exploitées- et d’une réalisation brouillonne, surtout les scènes d’action souvent illisibles. Boyle bâcle beaucoup mais emporte l’adhésion grâce à une sincérité et une ambition irréprochable. Sunshine est donc un film hybride, situé à mi-chemin entre Michael Bay et Stanley Kubrick, presque contre nature, qui laisse trop souvent le spectateur sur sa faim à vouloir trop embrasser de sujets, sans en approfondir aucun (A l’exemple de la découverte du vaisseau de la mission précédente, tombeau spatial magnifique qui aurait pu / dû rendre tellement plus visuellement et émotionnellement). Reste un film attachant qui est aussi loin d’être une purge qu’un chef d’œuvre.
Publié le 6 Avril 2008